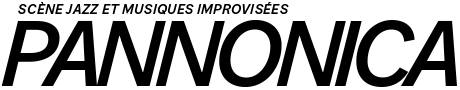18 avril, 17h45. Fin des balances pour le quintet de Léon Phal, saxophoniste et compositeur responsable du remarqué Stress killer sorti en septembre 2023, qui doit se produire le soir même sur la scène de la salle Micro de Stereolux. L’entretien a lieu dans les loges autour d’un verre de soda bio local.
Dans le rock, on parle de guitar hero, te sens-tu, Léon Phal, comme un sax hero ?
Pas du tout. Je ne me suis jamais senti ni virtuose, ni excellent. Je continue à faire mes gammes à la maison. Je me considère plutôt comme un compositeur et j’essaie de mettre les musiciens avec qui je travaille à l’aise sur scène, c’est-à-dire de leur énoncer des propos suffisamment évidents pour que tout le monde sache où l’on va. Et quand je m’adresse au public, j’essaie d’être le plus simple possible également : je me positionne comme un diffuseur d’huiles essentielles, un diffuseur de bonnes vibes !
Sur ton dernier disque, Stress Killer, j’ai noté que les cuivres ne sont pas systématiquement mis en avant.
Ce groupe-là porte mon nom parce que c’est moi qui apporte les compositions. Je me positionne comme un compositeur, mais aussi comme un orchestrateur. J’utilise les instruments qui sont autour de moi pour aller jusqu’au bout de l’idée de l’arrangement d’un morceau, pas pour mettre en avant quelqu’un. Si l’idée me dicte d’avoir un solo de synthé plutôt qu’un solo de sax, je ne vais pas hésiter à donner le solo au synthé.

Tu cherches davantage à mettre en avant tes compositions ?Exactement. Parce que, avec ce groupe la palette des sons et des époques est très très large. Il y a de la soul, de la house, de la deep house, du hip hop, de l’afrobeat… Comme on fusionne énormément d’esthétiques, pour faire les choses simplement, on essaie de ne pas forcer le trait, d’être assez parcimonieux.
J’ai lu que tu faisais des maquettes avant de proposer tes morceaux aux autres membres du groupe.
Avec les maquettes, chacun a le temps de se préparer, d’avoir des idées et de jouer ses propres parties. Je les envoie à tout le monde et après on se donne rendez-vous en studio.
Tu as 33 ans, c’est ton troisième disque. En quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ?
J’ai été très impressionné par Gauthier Toux, que je connais depuis 2011. Il a enregistré son premier album à 21 ans. Moi à cet âge, je travaillais mes gammes, mon sax, je faisais des concerts, je commençais à faire pas mal de trucs différents, à produire dans mon coin, avec d’autres, du funk, du hip hop, du reggae. Je travaillais dans plein de projets différents, mais je n’en étais pas encore à dire : « Ah, ça c’est ma musique ! Asseyez vous et écoutez ce que je fais. » À une période, j’étais très demandé en tant que saxophoniste accompagnateur, comme la plupart des musiciens qui jouent dans mon quintet – Arthur Alard, Zacharie Ksyk et Rémy Bouyssière, des musiciens vraiment hors pair qui ont plutôt une carrière de sidemen. C’était aussi mon cas pendant quelques années, jusqu’à ce qu’on ne m’appelle plus du tout. Cela arrive dans la carrière de n’importe quel musicien d’avoir des périodes de vaches maigres.
Tu es aussi passé par l’enseignement ?
Oui, mais dans la même période, j’ai démissionné de mon master pédagogie, du coup je ne pouvais plus enseigner en Suisse (NDLR: Léon est franco-suisse). Financièrement, j’étais un peu dans la dans la merde… J’ai dû prendre une décision et me suis dit qu’il était temps de monter mon propre groupe. Il y a eu une petite phase de dépression entre 27 et 28 ans. Ça a duré une bonne année. Je me suis reconstruit, j’ai mis un peu de terreau dans le pot, j’ai changé un peu la terre, j’ai attendu que les idées s’aèrent et j’ai composé mon premier album que j’ai proposé aux musiciens dont on a déjà parlé. Ils m’ont suivi. Le disque a été très bien accueilli par la presse spécialisée. C’est ce qui nous a propulsés sur scène. Du coup, j’ai sorti un premier album à 28 ans. Je n’étais pas vraiment pressé de faire mon truc. Je voulais attendre de le faire au bon moment. En toute honnêteté, je ne suis toujours pas prêt pour ce qui est en train de se passer actuellement, mais je fais en sorte de me préserver pour continuer. Maintenant, l’idée c’est juste d’essayer de se reposer entre chaque concert, entre chaque tournée, et de se nourrir un peu intellectuellement.
Sur le disque, tu reprends Naïma de John Coltrane. J’imagine que c’est une référence pour toi.
Coltrane, c’est le gars qui m’a donné envie de jouer du saxophone, tout bonnement. J’avais neuf ans, j’étais dans la voiture de mon père le jour où j’étais censé choisir l’instrument que j’allais pratiquer à l’école de musique. Il a passé Giant Steps dans la voiture. Je me suis dit « Wouah, c’est exactement ça que je veux faire! » Mon père était chanteur et guitariste de musique punk. J’avais déjà assisté à beaucoup de ses concerts. Et du coup, j’ai été tout de suite touché par l’énergie qui se dégageait de la musique de Coltrane.
Juste un mot sur les décès récents de Pharoah Sanders et Wayne Shorter.
Deux grands papas. J’ai bien sûr adoré Harvest time de Pharoah Sanders, mais je me sens plus proche de Wayne Shorter dont j’ai épluché les œuvres à différentes périodes de ma vie. C’est quelqu’un qui a su traverser les époques et l’histoire du jazz.
Il y a des saxophonistes dans la scène actuelle qui te parlent comme ont pu le faire Wayne Shorter ou John Coltrane ?
C’était vraiment un but que je m’étais fixé, trouver un héros contemporain. J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver : c’est Walter Smith III, un saxophoniste de 43 ans, qui joue avec le trompettiste américain Ambrose Akinmusire. C’est quelqu’un qui m’a vraiment passionné pendant mes études.
J’ai découvert récemment un autre saxophoniste, qui a été élève de Walter Smith III, et qui s’appelle Josh Johnson. C’est un altiste. Il joue beaucoup avec Jeff Parker. C’est mon nouveau héros parce qu’il est producteur également et qu’il représente ce que j’aimerais incarner : il défend la musique avant-gardiste qui n’hésite pas à groover et il se sape !

Le fait justement de mêler le jazz à la house, à la techno, au hip hop, d’avoir un son réellement groove qui invite à la danse, est-ce qu’il y avait une volonté chez toi de secouer un peu le monde du jazz, d’affirmer que c’est une musique vivante, actuelle ?
C’est marrant, mais pas du tout ! Je n’ai jamais eu la prétention déjà d’inventer quoi que ce soit et de vouloir changer les choses, juste la volonté de faire quelque chose qui me ressemble, d’être le plus transparent possible avec ce que je ressens et qui je suis vraiment. Je ne me suis jamais dit que j’allais mettre un gros coup de pied dans la fourmilière dans la mesure où je n’aurais jamais pensé qu’on aurait un jour cette visibilité-là.
On parle de « New French Touch », avec Ishkero, Émile Londonien, Antoine Berjeaut. Te sens-tu appartenir à cette scène ?
Ça me fait plaisir que les gens essaient de nous fédérer, parce que la vie d’artiste, c’est une vie relativement cloisonnée. On se respecte, on s’aime beaucoup, mais on ne se mélange pas trop, avoir l’opportunité de jouer, c’est ce qui nous motive. Je suis très content qu’il y ait des gens qui s’intéressent à ça, qui essaient de mettre un nom, même si mettre un nom, c’est le meilleur moyen de tuer un mouvement musical. Mais d’un autre côté, c’est ce qui permet aux journalistes, aux professionnel·le·s de situer les choses.
Tu dis souvent que la nouvelle scène jazz anglaise est mise en avant, alors qu’en France émerge un courant similaire et au moins aussi intéressant…
La grande différence c’est qu’ici on n’a pas de Gille Peterson (NDLR : DJ, homme de radio, producteur et propriétaires de labels musicaux à Londres). On n’a pas cette culture du DJ et du club. Ce n’est jamais venu. On a eu des pionniers comme Laurent Garnier, mais c’est une musique en France qui n’a jamais été vraiment respectée. On est loin d’être aussi ouverts d’esprit que les Anglais.
Ce concert ce soir à Stereolux est en partenariat avec Pannonica, et Les Rendez-vous de l’Erdre, alors je vais faire ma Baronne de Koenigswarter : si tu devais figurer dans le livre Les musiciens de jazz et leurs trois vœux, quels seraient les tiens ?
Très chouette question. J’espère que les gens continueront à écouter de la musique, qu’il y aura encore des parents qui enseigneront la curiosité et le respect. C’est ça le plus important. On a besoin des jeunes pour y arriver, pour survivre. Ce sont les jeunes qui se déplacent aux concerts : on a besoin d’eux·elles et de leur curiosité.
Propos recueillis par John Doe
CRÉDIT PHOTO EN BANNIÈRE : © STANISLAS AUGRIS / DANS LE CORPS DE L’INTERVIEW : LÉON PHAL QUINTET À STEREOLUX © ANOUK ALLAIN